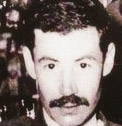#Algérie #France #Macron #nation #colonialisme
Suite à la sortie de ce soi-disant très cultivé Macron en septembre devant 18 étudiants, quant à la présence ou non d'une nation algérienne avant la colonisation française, voici ce qu'on m'a transmis. Des questions se posent. Rien n'est simple dans cette histoire ancienne (XVIème au XIXème). Sous certains aspects les échanges entre l'Algérie et la France ont pu être profitables aux deux. Mais c'est oublier l'abominable nuit du 17 octobre 1961 où 100 à 200 (peut-être plus) Algériens ont été noyés dans la Seine.
1) « LE CONTEXTE COLONIAL A PERMIS A LA NATION ALGERIENNE DE SE RENOVER, MAIS IL NE L’A PAS CREEE »
TRIBUNE DE #HOUARI_TOUATI
« Est-ce qu’il y avait une nation algérienne avant la colonisation française ? » Nombreux sont les témoignages historiques qui répondent positivement à cette fausse question – au sens rhétorique du terme – posée par le président Emmanuel Macron et héritée du temps de la colonisation triomphante de la France. Sans encombrer le propos, il est possible de s’en tenir à quelques exemples.
Un contemporain qui habitait à Constantine appelle lui aussi « Maghreb » cette partie occidentale du pays dont Tlemcen fut la capitale au Moyen Age. Mais il le distingue de son pays, le Constantinois, qui continuait comme dans le passé de s’identifier à l’Ifrīqiyā, c’est-à-dire l’actuelle Tunisie.
A la même époque, un document administratif daté de 1632 parle du « waṭan al-Jazā’ir » et de « sa frontière bien connue avec le waṭan de Tunis ». Mais le même document fait mention du « waṭan de Bône » (Annaba), du « waṭan d’Ulād Manṣūr » (région de M’Sila) et même du « waṭan du Tell » (nord de l’Algérie)… Un siècle plus tard, la notion de « patrie » demeure toujours aussi flottante sémantiquement sous la plume du voyageur kabyle al-Warthilānī, qui, lorsqu’il dit « notre waṭan » (ou « notre pays »), désigne tantôt sa tribu, tantôt la Kabylie, tantôt l’Algérie.
Le « waṭan », du village au pays
Le vocable « waṭan » a donc désigné avant la colonisation française de l’Algérie plusieurs cercles concentriques qui vont du plus petit, qui est le lieu de naissance et de résidence, au plus grand, qui est une entité territoriale avec sa frontière connue et reconnue – usage introduit au Maghreb par les Ottomans –, en passant par un cercle intermédiaire, qui est celui de l’unité administrative dirigée par un représentant de l’autorité centrale (khalifa), toujours un autochtone.
Il est en effet remarquable de relever que deux témoins appartenant à deux régions aussi contrastées que la campagne de Tlemcen et la montagne de Kabylie aient le sentiment d’appartenir au même pays et à la même communauté qui l’occupe. La question est de savoir si cette communauté à laquelle nos deux témoins s’identifient est une nation ou non.
Né dans le siècle de l’un de nos deux témoins et ayant vécu dans le siècle de l’autre, Montesquieu n’aurait eu aucune difficulté à considérer qu’ils appartiennent bel et bien à la même nation, à partir du moment où ils ont le sentiment (exprimé dans la même langue) d’avoir la même « patrie » et qu’ils lui ont l’un et l’autre manifesté leur attachement par l’utilisation du possessif « notre ». Evoquant les Indiens du Brésil, le penseur français leur attribue d’être une nation.
Dans cette acception, le mot figure dans le Dictionnaire de l’Académie française (1694), laquelle en fait un « terme collectif » désignant « tous les habitants d’un mesme Estat, d’un mesme pays, qui vivent sous mesmes loix, & usent de mesme langage […] chaque nation [ayant] ses coustumes […] ses vertus & ses vices » déterminés par l’humeur.
On reconnaît là la conception galénique de la nation qui n’était pas étrangère aux musulmans. On la rencontre chez le philosophe al-Fārābī exprimée en ces termes : « La communauté humaine parfaite absolument se divise en nations. Telle nation se distingue de telle autre par deux choses naturelles : par les caractères physionomiques et les types naturels de tempérament ; et par une troisième chose, conventionnelle, à savoir la langue. »
Le terme « umma » utilisé par le philosophe de langue arabe est celui qui est en usage de nos jours pour désigner la nation. Au caractère physique et moral et à la langue, celui qu’on surnommait le « second maître » après Aristote ajoute la religion, à quoi l’entrée « nation » de la première édition du Dictionnaire de l’Académie française ne s’oppose pas.
Islamisation et arabisation
Les deux témoins mentionnés, le Tlemcénien et le Kabyle, étaient assurément des lettrés musulmans. Mais plutôt que d’être des oulémas, ils étaient des soufis, des saints. C’est cet islam-là, communiant dans le culte des saints, qui est la religion du pays et le ciment de son unité. Non que le pays ait tourné le dos à la tradition des écritures islamiques savantes, mais il en a fait une source de l’autorité religieuse qui n’est pas plus importante que celle que procurent les facultés miraculeuses dont se prévalent les saints locaux depuis le milieu du Moyen Age.
Partout, les complexes religieux – les zaouias – qui sont érigés transforment la morphologie religieuse du pays ainsi que sa sociologie. Leurs fondateurs, des saints berbères pour la plupart, œuvrent à l’islamisation des campagnes aussi bien qu’à leur arabisation, tout en se servant des langues vernaculaires (différents berbères et arabe dit vulgaire), qu’ils sont les premiers à transformer en langues écrites en les graphiant dans l’écriture même du Coran.
Cette nouvelle forme d’islamisation a grandement œuvré à la constitution d’une identité nationale. La transformation de l’islam scripturaire en une religion vernaculaire a produit un effet qui est assez comparable à celui que décrit Colette Beaune dans Naissance de la nation France (1985), lorsqu’elle fait de la sainteté un puissant vecteur de l’unité de la nation, qui, pour exister, doit s’inscrire dans le sacré et participer à son prestige.
Article réservé à nos abonnés
S’agissant des artisans de la conquête de l’Algérie, ils n’ont jamais nié avoir rencontré sur le terrain une « nationalité vivace », comme le rappelle en 1858 le gouverneur de l’Algérie, le maréchal Randon, qui fait suite à la déclaration du général Bugeaud devant le Parlement en sa session du 8 juin 1838. Ils n’ont divergé que sur le fait de savoir si cette nationalité qu’ils combattaient préexistait à leur arrivée dans le pays ou si elle était de date récente.
Ceux qui la tenaient pour une nouveauté en avaient attribué l’œuvre au « champion de la nationalité arabe » et de l’« unité nationale » : l’émir Abdelkader. Tout en reconnaissant le rôle de ce dernier, les autres en ont fait moins le fondateur que le restaurateur, après que les Turcs l’eurent mise à mal.
Mais tous sont d’avis que dès 1847, « la nationalité arabe est à jamais détruite ». Ils n’avaient pas prévu qu’elle allait se régénérer et se redéployer sous une nouvelle forme quelques décennies plus tard, aux termes desquelles la société algérienne est sortie radicalement bouleversée.
L’amour de la patrie, un acte de foi
Dans les années 1900, de nouveaux groupes sociaux émergent pendant qu’une élite éduquée à la française se constitue et crée un mouvement de droits civiques animé par ceux qu’on nomme depuis peu les Jeunes-Algériens, organisés sur le modèle de ce qui existait en Italie, en Turquie, en Egypte et en Indonésie. De nouveaux cadres de socialisation se constituent : syndicats, cercles et associations se substituent aux complexes religieux des zaouias, avant que le parti ne fasse son apparition à l’entre-deux-guerres.
Dans ce nouveau contexte historique, des transformations radicales affectent la notion de nation. La plus importante est celle qui a consisté, dès 1903, à établir pour la première fois dans un texte algérien une équivalence dogmatique entre l’amour de Dieu et l’amour de la patrie (« ḥubb al-waṭan »), qui devient un acte de foi sanctifié par un prétendu hadith (parole ou action attribuée au prophète).
Cette transformation doctrinale a ouvert aux Algériens la voie à la réception de la notion de droit des nations à disposer d’elles-mêmes, pendant que la notion de république devenait chez eux l’expression la plus aboutie de ce que devait être la nation. Si, par conséquent, le contexte colonial a permis à la nation algérienne de se rénover en se modernisant, il ne l’a pas créée. Il l’a en revanche surdéterminée, sans lui faire perdre ses anciennes attaches. Cela dit, il est non moins vrai que ce n’est pas le nationalisme qui a créé la nation en Algérie.
Houari Touati est directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS, Paris).
2) TRIBUNE (#Le_Monde 30.10.2021) de M. #M_HAMED_OUALDI #
Professeur des universités, historien à Sciences Po, où il dirige « Voix d’esclaves », projet de recherche sur la fin de l’esclavage au Maghreb du XVIIIe au XXe siècle, soutenu par le Conseil européen de la recherche.
Lors d’un échange avec dix-huit jeunes à l’Elysée, le 30 septembre, le chef de l’Etat a affirmé qu’avant l’occupation française de l’Algérie, il « y avait de précédentes colonisations ». Selon Le Monde, il ajoutait : « Moi, je suis fasciné de voir la capacité qu’a la Turquie à faire totalement oublier le rôle qu’elle a joué en Algérie et la domination qu’elle a exercée. Et d’expliquer qu’on est les seuls colonisateurs, c’est génial. Les Algériens y croient. »
Le président français affirmait récemment que la Turquie était parvenue à faire oublier « la domination » qu’elle a exercée en Algérie. Faux rétorque, dans une tribune au « Monde », l’historien M’hamed Oualdi, qui rappelle que, « à l’inverse des Français », les Turcs n’ont pas envahi Alger.
Le président Macron se trompe au moins pour cinq raisons lorsqu’il assimile à une colonisation la tutelle de l’Empire ottoman sur la province d’Alger du début des années 1520 au début des années 1830.
A l’évidence, la Turquie n’est pas l’Empire ottoman. Ce pays n’est qu’un des nombreux successeurs d’un vaste empire polyglotte et cosmopolite qui s’étendait de la province d’Alger jusqu’à l’Euphrate, et des Balkans jusqu’aux portes du Sahara.
Plus important, à l’inverse des Français, les Ottomans n’ont pas envahi Alger. Ce sont les élites de cette ville, des marchands, des savants religieux et des notables qui ont fait appel aux sultans d’Istanbul à partir de 1519. Les Algérois ont recherché l’appui d’une puissance musulmane pour faire face au danger que représentaient les offensives lancées par les Habsbourg chrétiens d’Espagne sur les côtes du Maghreb.
Etat militaro-fiscal
Plus révélateur encore : comme dans d’autres provinces ottomanes au Maghreb, ces gouverneurs d’Alger (les deys) disposaient d’une large marge de manœuvre. Ils signaient des traités avec des puissances européennes sans toujours en référer à Istanbul. Ils récoltaient des impôts qu’ils utilisaient au sein de la province et qu’ils n’avaient pas à reverser à Istanbul. Rien à voir avec le fort contrôle de l’Etat français sur les trois départements de l’Algérie. Et pour cause, l’Empire ottoman et l’Etat colonial français ne disposaient pas des mêmes techniques de gouvernement. Le sultanat ottoman est un empire d’Ancien Régime qui gouverne de vastes étendues avec des ressources limitées, par l’usage combiné de la négociation et de la répression. La France coloniale se fonde sur un Etat moderne, militaro-fiscal, fruit des révolutions, de l’Empire et de ses guerres totales, de l’imprimé et du télégraphe…
ticle réservé à nos abonnésAutre différence notable : le pouvoir ottoman n’a jamais cherché à encourager des migrations massives pour occuper des terres au Maghreb. Istanbul a certes envoyé de manière régulière quelques milliers de soldats, des janissaires, vers la province d’Alger comme vers les provinces voisines de Tunis et de Tripoli. Ces soldats, venus surtout du centre de l’Empire, d’Anatolie et des Balkans, ont – il est vrai – réprimé dans la violence des soulèvements locaux. Ils se sont emparés de ressources foncières, notamment de terres aux alentours des principales villes. Mais les effectifs de ces soldats n’étaient en rien comparables aux troupes françaises et aux colons européens qui se sont installés en Algérie.
En 1954, au début de la guerre d’Algérie, le nombre de ces colons atteint le million pour 9 millions d’Algériens musulmans. Minoritaires, ces colons se sont emparés au bas mot de 40 % des terres des populations musulmanes. Et lors des quarante cinq premières années de l’occupation française, entre 1830 et 1875, selon le démographe Kamel Kateb, la « surmortalité, du fait de la guerre de conquête et des opérations de répression » est estimée à 825 000 morts sur une population musulmane qui aurait avoisiné les 3 millions en 1830 !
« Des pays comme l’Algérie auraient toujours été colonisés par les “Arabes”, puis par les “Turcs” et enfin par les Européens. Comme si ces sociétés avaient été apathiques »
Enfin, dans ce climat de très forte violence, après 1830, l’autorité des sultans ottomans continuera à être reconnue par une partie des sujets algériens de l’ancien empire. Certains envoient des pétitions au sultan, encore perçu comme un recours. Des Algériens refusent de devenir des nationaux français de seconde zone, sans droits civiques et politiques. Ils décident de migrer vers les terres ottomanes, entre Tunis et Istanbul, en passant par l’Egypte et la Syrie. En Algérie même, des prêches de mosquée sont introduits au nom des sultans jusqu’à la chute de l’empire, au lendemain de la première guerre mondiale. Bien d’autres faits infirment la thèse d’une colonisation turque de l’Algérie. Le cas de la colonisation française de l’Algérie – il faut toujours le souligner – est spécifique par la violence de la conquête, la violence de l’occupation puis la violence de la décolonisation.
Essai de dynamitage du rapport Stora ?
Mais d’où vient cette thèse d’une colonisation turque ? Une précipitation à vouloir concrétiser ou au contraire à chercher à dynamiter dans un contexte de campagne électorale, les recommandations du rapport Stora [rapport sur la réconciliation mémorielle entre la France et l’Algérie remis par l’historien Benjamin Stora à Emmanuel Macron le 20 janvier] ? Il faut aussi chercher du côté des chaînes d’information en continu et de certains journaux. Ces médias reprennent de vielles antiennes depuis longtemps nuancées ou démenties par les historiens : ainsi l’idée très coloniale que des pays comme l’Algérie ont toujours été colonisés par les « Arabes », puis par les « Turcs » et enfin par les Européens. Comme si ces sociétés avaient été apathiques. Comme si elles étaient appelées à toujours être colonisées.
D’autre part, cette déclaration présidentielle nous invite à nous pencher sur l’état de nos connaissances sur l’histoire de l’Algérie et du Maghreb. La recherche française a formé des historiens et des historiennes de renom, créatifs et critiques sur la colonisation de l’Algérie et de l’Afrique du Nord. Dans le même temps, ces historiens ont trop longtemps distingué le Maghreb et l’Empire ottoman, alors qu’à l’exception du sultanat du Maroc, ces deux mondes se sont plus que croisés, ils se sont entremêlés du XVIe au XIXe siècle. De ce point de vue, le chef de l’Etat français est mieux informé lorsque, au cours de ce même déjeuner du 30 septembre, il appelle à une production éditoriale en langues arabe et amazigh : deux des nombreuses langues historiques du Maghreb avec entre autres, le judéo-arabe, le français, l’italien, le haoussa, le kanouri, l’espagnol… et le turc ottoman.
Photo : Abdelkader à Alger





/image%2F1177296%2F20211207%2Fob_f8ef41_camp-algeriepng.png)