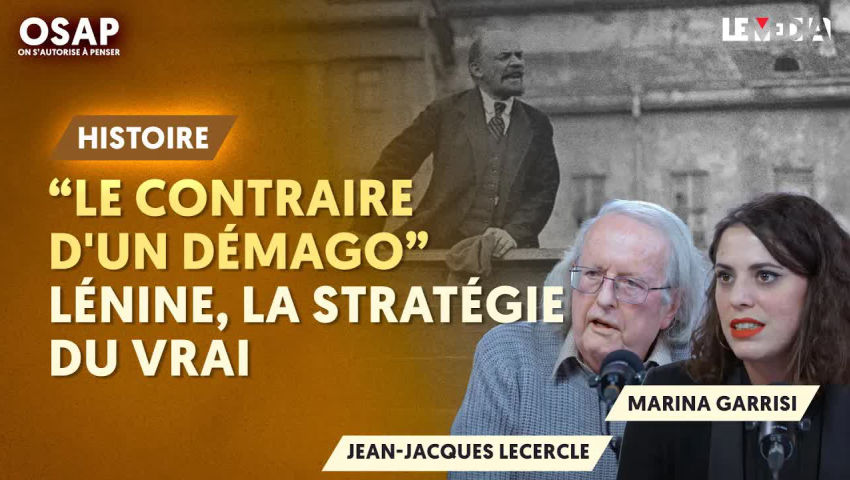David Harvey : « En France, le néolibéralisme devient violent et autocratique » | Mediapart
#politique #marxisme #socialisme
David Harvey est une des figures les plus importantes du marxisme contemporain. De passage à Paris, il a rencontré Jean-Luc Mélenchon le 12 avril, à l’invitation de l’Institut La Boétie. Grand critique du capitalisme, inlassable porteur de la pensée de Karl Marx, géographe penseur des effets concrets du capital sur l’espace, ce Britannique de 88 ans est un observateur toujours affûté de la réalité économique, sociale et géographique.
En marge de cette rencontre et d’une série d’autres interventions en France, David Harvey a accepté de répondre aux questions de Mediapart à propos de l’état actuel du capitalisme, de sa relation avec l’ancien candidat de La France insoumise (LFI) à la présidentielle, et de Marx.
Illustration 1
David Harvey à Paris, en avril 2023.
Mediapart : Votre réflexion sur le capitalisme comporte une importante théorie des crises. Depuis 2020, une nouvelle crise semble s’être ouverte, qui vient de connaître avec la crise bancaire un nouvel épisode. Quel est votre sentiment sur l’état actuel du capitalisme ?
David Harvey : Je voudrais isoler quelques faits pour répondre à cette question. Le premier, c’est qu’il est très difficile de se représenter aujourd’hui ce que pourrait être le futur du capitalisme parce que la direction que prendra la Chine, qui est un acteur crucial, n’est pas claire.
Ma vision est que la Chine a permis au capitalisme, en 2007-2008, d’éviter une dépression comparable à celle des années 1930. Depuis ce moment et avant l’arrivée du Covid, la Chine a représenté environ un tiers de la croissance mondiale, ce qui est davantage que les États-Unis et l’Europe réunis. Donc il est impossible, dans les circonstances présentes, de prévoir la direction que prendra le capitalisme sans savoir celle que prendra la Chine.
Le deuxième élément qui me semble important est que, à l’intérieur du monde capitaliste, il y a eu de sérieux crashs financiers depuis 1980. À chaque crise, les banques centrales ont répondu en augmentant la liquidité. À présent, nous nous dirigeons vers la prochaine crise qui nécessitera encore plus de liquidités. Pour moi, nous sommes donc dans une situation dangereuse où le capital s’accumule sous l’effet de ces infusions de liquidités.
Tout cela ressemble à une chaîne de Ponzi mondiale [un montage financier frauduleux – ndlr] et les chaînes de Ponzi finissent souvent très mal. La difficulté dans ce cas, c’est qu’il n’existe pas de possibilité pour les États de permettre une crise financière si la finance occidentale est fondée sur une chaîne de Ponzi… Mais alors, la question est de savoir s’ils peuvent contenir cette crise et je ne suis pas sûr qu’ils le peuvent.
Le troisième élément qui est important pour moi est la question des transferts de technologie sur le plan international. Depuis les années 1950, les États-Unis n’ont pas freiné, et parfois même ont promu, les transferts de technologie vers le Japon, Taïwan ou la Corée du Sud. En faisant cela, ils cherchaient évidemment à contenir la Chine dans sa forme communiste et à l’encercler par un réseau de pays à revenus moyens à élevés.
Que s’est-il passé lorsque la Chine s’est ouverte ? Les capitaux du Japon, de la Corée du Sud ou de Taïwan se sont massivement investis en Chine, amenant avec eux les transferts de technologie passés. À présent, les États-Unis tentent de bloquer les transferts de technologie vers la Chine, ce qui à mon sens est une attitude stupide. En partie parce que c’est impossible, mais aussi parce que si l’on bloque le développement de la Chine, qui a systématiquement sauvé le capitalisme, on ne fait pas quelque chose de très positif pour le capitalisme.
Il y a beaucoup de divergences d’opinion aux États-Unis, mais s’il est une chose sur laquelle le Congrès est unifié avec la présidence Biden, c’est bien sa politique anti-chinoise. Si cette politique réussit, nous verrons, je pense, le monde tomber dans une croissance négative. Et cela conduira à de nombreuses oppositions, à des mécontentements, à de l’agitation et à des soulèvements. Nous voyons déjà beaucoup de ces événements se dérouler sous nos yeux.
Ces trois éléments apparaissent effectivement comme des contradictions majeures du capitalisme contemporain. Dans votre œuvre, vous insistez sur le caractère endémique des contradictions, et donc des crises, dans le capitalisme. Selon vous, ces crises prennent toujours la forme de violents processus de dévaluation ou de dévalorisation du capital. Avec cette forte intervention de l’État, on a le sentiment que ce processus est bloqué. Qu’en pensez-vous ?
Non, en réalité, ce processus de dévaluation est déjà en cours. Il y a en permanence des dévaluations. Mais la vraie question est : qui va être dévalorisé ? En 2007-2008 aux États-Unis, sept millions de ménages ont perdu leur maison. Ils ont perdu 80 % de leur patrimoine dans la grande perte de valeur de leur demeure, principalement dans la communauté afro-américaine. En parallèle, les banques ont été renflouées. Il y a eu un transfert massif de droits de propriété vers les banques, avec des expulsions.
Ensuite, ces droits ont été vendus à prix bas, grâce au renflouement des banques, vers des entreprises comme Blackstone. Blackstone est à présent le principal propriétaire dans le monde. La perte de valeur des populations aux États-Unis s’est donc retrouvée dans la poche de Blackstone. Stephen Schwarzman, qui dirige cette entreprise, est maintenant un des principaux milliardaires de la planète. Et il a été l’un des principaux soutiens de Donald Trump.
Vous avez donc le choix : on peut renflouer les banques ou les gens. Et depuis les années 1970, le choix des gouvernements a toujours été de renflouer les banques. Ce que l’on voit, ce sont donc bien des dévalorisations des actifs et des économies des gens.
Et aujourd’hui ?
Aujourd’hui, je vois d’autres processus importants de dévaluation. Par exemple, on ne sait pas exactement combien de personnes ont perdu de l’argent dans la crise des cybermonnaies. Mais les investisseurs personnels pourraient avoir perdu jusqu’à 40 milliards de dollars. Beaucoup de gens riches, comme des sportifs, ont incité des gens à aller investir dans ces actifs en leur garantissant des rentabilités importantes. Et ces gens ont mis leur monnaie dans ces cybermonnaies. Maintenant, le marché s’est effondré et ils ont perdu.
Une concentration croissante de la richesse augmente la centralisation du capital, autour de sociétés comme Blackstone ou BlackRock.
David Harvey
En Chine, il se passe quelque chose de similaire avec la crise du développement immobilier. Xi Jinping a dit que l’immobilier était pour vivre dedans, pas pour spéculer, mais beaucoup de personnes ont spéculé en Chine. Dans le cas chinois, les gens achetaient des parts des futurs projets avant même qu’ils ne commencent. Des gens achetaient jusqu’à cinq ou six appartements et ils profitaient de la hausse du prix du marché entre le moment de l’achat et celui de la livraison.
Mais quand Evergrande, le principal développeur, est entré en crise, beaucoup de leurs appartements n’étaient pas terminés. Les gens se sont trouvés obligés de payer des traites de crédits pour quelque chose qui n’existait pas. C’est pourquoi il y a eu une grève des remboursements en Chine, ce qui a été très intéressant. Le gouvernement a donc dû accepter de prendre les choses en main et de finir les constructions.
Ce sont des choses difficiles à tracer dans le détail. Mais ce que l’on peut déduire de cela, c’est qu’une concentration croissante de la richesse dans 1 ou 10 % de la population augmente la centralisation du capital, autour de sociétés comme Blackstone ou BlackRock. Et pour moi, la menace de la dévaluation réside dans ce phénomène. Crédit Suisse a été racheté par UBS, deux ou trois autres banques ont été sauvées aux États-Unis, je pense qu’il y en aura d’autres… La dévaluation du capital est donc en cours à une échelle déjà significative. Les gouvernements et les banques centrales sont inquiets de ce qu’ils appellent la « contagion », c’est pourquoi ils tentent de contenir la crise. Nous verrons bien jusqu’où ils peuvent aller sans émettre de nouvelles masses de liquidités, puisque les banques centrales tentent de sortir de l’assouplissement quantitatif.
Illustration 2
David Harvey à Paris, en avril 2023. © Photo Sébastien Calvet / Mediapart
Comme Jean-Luc Mélenchon, avec qui vous avez débattu récemment, vous accordez une place importante à la ville dans votre théorie. Qu’est-ce qui vous rapproche de lui sur ce point ?
Je pense que nous partageons une critique de la marchandisation de la ville. La crise du logement est globale. À New York, il y a presque 60 000 sans-abri et des familles s’entassent dans des appartements étroits parce qu’elles ne peuvent rien s’offrir de mieux. Il y a un boom de l’immobilier qui revient à construire des logements pour les classes qui peuvent spéculer, alors que rien n’est fait pour la masse de gens qui désespèrent d’avoir un logement digne. Il faut contrôler les loyers et cesser de marchandiser le logement.
Mais sous le néolibéralisme, tout est marchandisé. C’est pourquoi je ne pense pas que sa fin soit advenue : l’éducation, la santé ou encore le logement sont encore trop marchandisés. Je ne vois aucun parti politique prendre ces questions de manière frontale, sauf Mélenchon et La France insoumise, et il y a beaucoup d’autres choses sur lesquelles nous nous rejoignons.
Vous avez aussi en commun d’intégrer l’aliénation par le temps dans votre critique de la vie urbaine quotidienne…
En effet, je pense, comme Henri Lefebvre [1901-1991, philosophe, inspirateur de l’Internationale situationniste, auteur d’une trilogie sur la Critique de la vie quotidienne – ndlr], que les gens sont aliénés par les conditions de la vie quotidienne, et notamment par le temps volé par le développement du capitalisme. C’est pourquoi je désespère de voir qu’il y a encore des programmes de gauche qui ne se concentrent que sur les conditions de vie matérielles.
Quand on parle d’aliénation, on parle d’un sentiment de perte de sens que l’énorme augmentation de la propagande bourgeoise – à travers les spectacles, les films, le divertissement – ne parvient pas à faire oublier. Je ne pense pas qu’à la fin de la journée, les gens se sentent satisfaits de leur style de vie. La précarité de l’emploi y est pour beaucoup. Dans les années 1960, quand les gens avaient des emplois stables, des positions stables, des voisins qu’ils connaissaient et rencontraient dans la rue, il était plus simple de trouver un sens à sa vie. Aujourd’hui, tout devient éphémère. Il faut qu’un projet politique s’empare de ce sujet, et du droit à la ville.
La théorie post-marxiste de Mélenchon sur « l’ère du peuple » est influencée par les philosophes Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, qui considèrent que le « peuple » est le nouveau moteur de l’histoire, et non plus la classe ouvrière. Quelle est votre position sur cette vision ?
Je suis en désaccord avec eux, mais je pense que ce que dit Mélenchon prend une autre direction. J’ai toujours trouvé que la gauche fétichisait la lutte des classes dans les usines de production et avait tendance à traiter les mouvements sociaux urbains, tels que la lutte contre la gentrification, comme des éléments secondaires. Ma version de la théorie marxienne est que ces éléments font partie d’un tout.
Quand certains parlent de « circulation de la capacité productive », moi je vois des travailleurs se battre contre des sociétés de cartes de crédit, contre des propriétaires terriens, contre des entreprises pharmaceutiques ou de téléphonie mobile. Pour moi, ça fait partie de la lutte des classes. Quand Laclau et Mouffe disent qu’il faut dépasser l’idée traditionnelle qu’on se fait du prolétariat, je suis donc sur leur ligne, mais je continue de travailler sur une base marxiste, alors que Laclau, en particulier, a tendance à vouloir jeter le bébé marxiste avec l’eau du bain populiste.
Je n’aime d’ailleurs pas vraiment le mot « populiste », mais je comprends ce que Mélenchon veut dire quand il affirme avoir besoin d’un mouvement qui va s’occuper de tout ce qui ne va pas dans la vie des gens, et pas seulement de la classe ouvrière traditionnelle, même si elle est toujours importante. Pour avoir discuté avec lui, je ne pense pas qu’il se sente particulièrement lié idéologiquement à Laclau et Mouffe, mais il voulait quelque chose de suffisamment large pour construire un parti politique et même, plus largement, un mouvement social autour des transformations de toutes les vies urbaines, et pas seulement des usines de production.
Vous dites qu’il faut intégrer la lutte contre l’aliénation dans un programme politique, mais peut-on construire un programme politique à vocation majoritaire dans la société tout en luttant contre l’aliénation de la majorité de la population ?
Oui, à ceci près qu’il faut régler un problème. Les populations aliénées ont une approche particulière de la participation politique. Elles sont généralement passives et en colère, mais peuvent soudainement devenir actives et très en colère. Et cette colère peut être orientée de différentes manières. Les populations aliénées ne soutiennent pas forcément des programmes de gauche, elles peuvent devenir fascistes, et de fait, il y a assez de preuves que, ces derniers temps, elles sont allées davantage vers l’extrême droite que vers la gauche.
La gauche doit capter cette colère et mobiliser ces populations qui ont une attitude passive-agressive. Malheureusement, elle ne s’y attelle pas. En Grande-Bretagne, au moindre signe de colère, le parti travailliste se retire en condamnant des « extrémistes ». Quand dernièrement trois parlementaires travaillistes ont osé rejoindre un piquet de grève, ils ont été exclus par les dirigeants du parti ! Le parti travailliste est au point mort. C’est pourquoi je pense qu’on peut apprendre de Mélenchon qui, pour ce que j’en sais, partage cette colère et n’en a pas peur : il sait d’où elle vient.
Illustration 3
David Harvey à Paris, en avril 2023. © Photo Sébastien Calvet / Mediapart
Dans Une brève histoire du néolibéralisme (Les Prairies ordinaires, 2017), vous écriviez que le néolibéralisme ne pourrait survivre qu’en devenant violent et autocratique. N’est-ce pas ce qu’on observe en France aujourd’hui dans l’attitude de Macron face aux mobilisations contre la réforme des retraites ?
Oui, c’est ce qu’on a sous les yeux, clairement. On se rapproche du fascisme des années 1930, c’est ce contre quoi il faut lutter.
Tout indique que la France est dans une impasse, entre un pouvoir sourd et une mobilisation qui s’épuise du fait de la répression. Vous qui avez travaillé sur les mouvements révolutionnaires et leur dimension urbaine, pensez-vous qu’une révolution du type du XIXe siècle peut encore arriver aujourd’hui ?
La situation aujourd’hui est radicalement différente de celle du XIXe siècle. Il n’y aura plus de prise de la Bastille ou de prise du Palais d’Hiver possible. Si on devait attaquer quelque chose, ça devrait être les banques centrales, mais que ferait-on une fois dedans ? (Rires) Durant la Commune de Paris, les insurgés ont, à l’inverse, protégé la Banque de France, et ils ne se sont rendu compte de leur erreur que trop tard. Aujourd’hui, le capitalisme est organisé d’une telle manière qu’à certains égards, il me semble quasiment trop gros pour s’effondrer.
Même si vous êtes pour une transition au socialisme, je devine que vous voudrez toujours avoir des téléphones portables, des ordinateurs, et donc Internet. Or, comment sont-ils fabriqués et par qui ? Ces entreprises sont rationalisées. Il est possible que, si elles s’effondrent, il n’y ait plus d’ordinateurs ni de téléphones portables. Si c’est ça le socialisme, il y a fort à parier que les gens vont réclamer le retour du capitalisme ! Les gens m’en veulent quand je dis ça, mais de manière réaliste, pouvez-vous imaginer une société socialiste qui préfère rejeter les ordinateurs, les outils de communication, l’intelligence artificielle au lieu de les utiliser ? Il faut y réfléchir.
J’aime beaucoup la réplique d’Henri Lefebvre quand on lui demandait pourquoi il était marxiste et pas anarchiste : “Je suis marxiste pour qu’un jour on puisse tous vivre comme des anarchistes !”
David Harvey
Étant donné qu’il est difficile de révolutionner la vie urbaine quotidienne et qu’il y a une conscience écologique de plus en plus aiguë, ne pensez-vous pas, comme Kristin Ross, que les révolutions partiront désormais des campagnes, des zones à défendre ?
Toute l’histoire du capital est parsemée de mouvements alternatifs de ce type. Ils ne sont ni absurdes ni inutiles. Ces mouvements peuvent être les germes de la construction d’une alternative réelle. Si je pouvais tout planifier, je m’assurerais qu’on sorte de la métropolisation, les gens travailleraient à distance de la métropole – c’est désormais possible –, les structures communales seraient écologiques, les gens auraient tous leur parcelle de terrain pour cultiver des légumes. C’est une réponse importante aux problèmes soulevés par l’agriculture capitaliste. Je vivais en Grande-Bretagne durant la Seconde Guerre mondiale, quand 50 % de la production alimentaire venait des potagers des gens ! Il y beaucoup de choses qui peuvent naître de ces alternatives. Là encore, ça va me causer des problèmes avec les marxistes orthodoxes, car parfois, je dis des choses qui me font passer pour un anarchiste ! (Rires)
En fait, vous êtes plus Kropotkine que Marx !
Oui, et Élisée Reclus ! Je les aime bien. J’aime beaucoup la réplique d’Henri Lefebvre quand on lui demandait pourquoi il était marxiste et pas anarchiste : « Je suis marxiste pour qu’un jour on puisse tous vivre comme des anarchistes ! » C’est une très bonne réponse ! Je suis un anarchiste ancien modèle, j’aime lire Murray Bookchin, Kropotkine, Élisée Reclus, ça mérite d’être incorporé, et amélioré, à nos considérations. Cela fait sans doute de moi une sorte d’hérétique.
Vous avec beaucoup fait pour aider la pensée marxiste à survivre au rouleau compresseur néolibéral. Vous avez récemment publié A Companion to Marx’s Grundrisse (Verso, 2022, non traduit). Pourquoi est-il toujours important pour vous de lire Marx et de parler de sa pensée ?
Vous pourriez dire que je suis un peu obsessionnel ! La première raison, c’est que je ne supporte pas le courant hégémonique de l’économie contemporaine. C’est tellement erroné ! Je pense que Marx a construit une manière de comprendre le capital et l’économie qui est bien plus précise et pertinente que celle des économistes bourgeois. Je veux les défier. Ce n’est pas facile, car ils ont l’argent, ils ont les médias, ils ont la « crédibilité ». Mais prenons des exemples.
David Ricardo [économiste britannique, 1772-1823 – ndlr] avait une théorie de la valeur liée au travail. Beaucoup de gens qui travaillent sur cette tradition regardent la situation et disent : si le travail est la source de toute valeur, comment se fait-il que le travail soit si peu rémunéré ? C’est une question morale évidente ! C’est de là que vient le « socialisme ricardien » dans les années 1840, qui a donné naissance au socialisme de John Stuart Mill [économiste britannique, 1806-1873 – ndlr]. Celui-ci affirme qu’on ne peut rien faire au niveau de la production, mais qu’on peut redistribuer autant que possible la valeur aux gens qui la produisent. Thomas Piketty, Elizabeth Warren et Bernie Sanders s’inscrivent dans cette tradition.
Marx n’aimait pas cette tradition parce qu’elle ne prend pas en compte la production. Mais elle pose une question morale fondamentale, qui est devenue très puissante dans le mouvement chartiste, dans les années 1840 [un mouvement ouvrier qui s’est développé au Royaume-Uni au milieu du XIXe siècle, après l’adoption de la « Charte du peuple » – ndlr].
Puis, des économistes marginaux ont dit : il ne faut plus penser la valeur seulement à partir du travail, mais en additionnant la valeur de la propriété, du capital et du travail. L’importance de ces trois facteurs de la production vient de leur rareté relative : si les capitalistes ont peur de manquer, ils sont légitimes à recevoir bien plus que le travail, qui est abondant. Les grands patrons de Manchester étaient ravis de cette nouvelle théorie économique car elle éradique la question morale, et la théorie de John Stuart Mill n’a survécu qu’à travers certaines formes de social-démocratie à partir de 1945.
Aujourd’hui, le capital repose toujours sur cette théorie de la valeur ! Elle légitime des taux de rentabilité plus élevés pour le capital, à tel point qu’il y a des capitaux excédentaires. Il devrait donc y avoir un rééquilibrage en faveur du travail, mais bien sûr ce n’est pas ce qui se produit. Si vous dites à un économiste, dans n’importe quelle faculté, de prendre cette théorie de la valeur au sérieux, il vous rira au nez ! C’est ridicule.
C’est pourquoi il faut revenir à cette question morale. Car, une fois que vous l’avez posée, les gens commencent à s’interroger et, dès lors, il est possible de passer à la prochaine étape qui est de poser la question de la destruction de la production capitaliste. C’est pour cette raison que Marx me donne une alternative. Il pense que le capital n’est pas quelque chose, comme le pensent les économistes bourgeois, mais que c’est un processus dans lequel il prend différentes formes. Il a cette incroyable flexibilité.
D’autre part, Marx m’est très utile pour comprendre des phénomènes d’urbanisation. Marx explique par exemple que les capitalistes investissent dans des activités improductives à dessein, pour éviter le surplus de production créé par leurs investissements. Regardez l’urbanisation contemporaine dans les États du Golfe, c’est assez éloquent ! Les capitalistes investissent dans des activités improductives, à des taux énormes, pour faire du profit. Ils le font en partie pour des raisons écologiques car la pression sur l’environnement serait autrement catastrophique.
Mon objectif est de diffuser une théorie marxiste qui soit compréhensible, d’être pédagogue, pour que les syndicats et les mouvements sociaux puissent s’en saisir. En un sens, c’est la raison pour laquelle l’hégémonie marxiste s'est effondrée dans les années 1980 : trop sophistiquée, elle n’avait pas de camp de base réel pour expliquer ce qui se passait dans la vie quotidienne. Je pense que cette erreur est en cours de réparation.
https://www.mediapart.fr/journal/politique/180423/david-harvey-en-france-le-neoliberalisme-devient-violent-et-autocratique