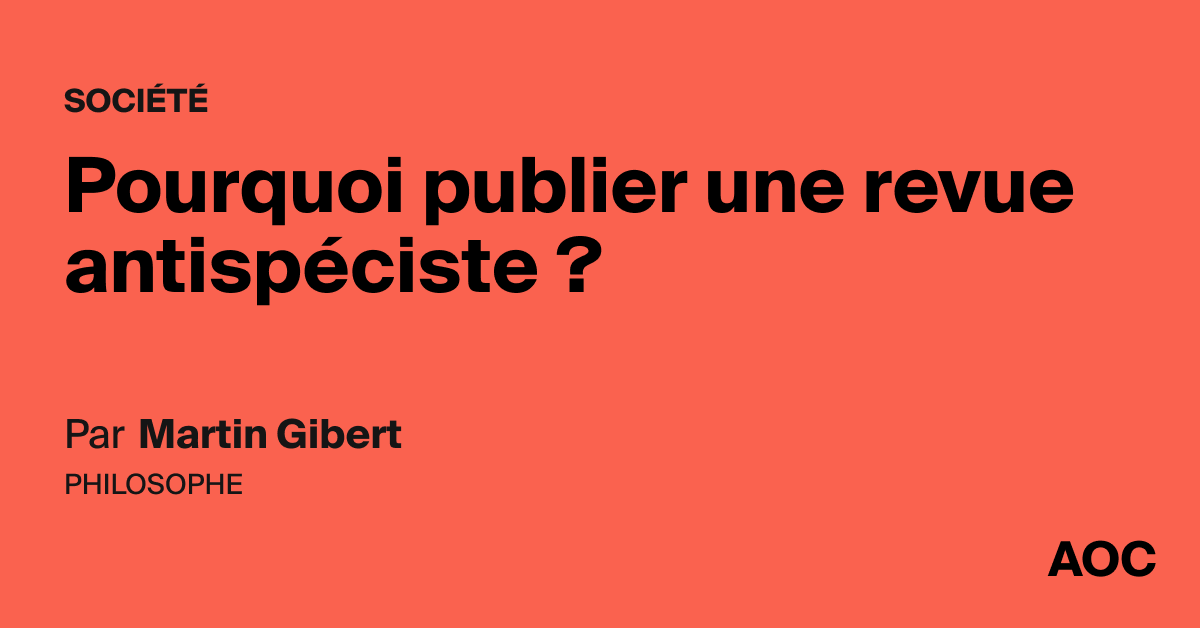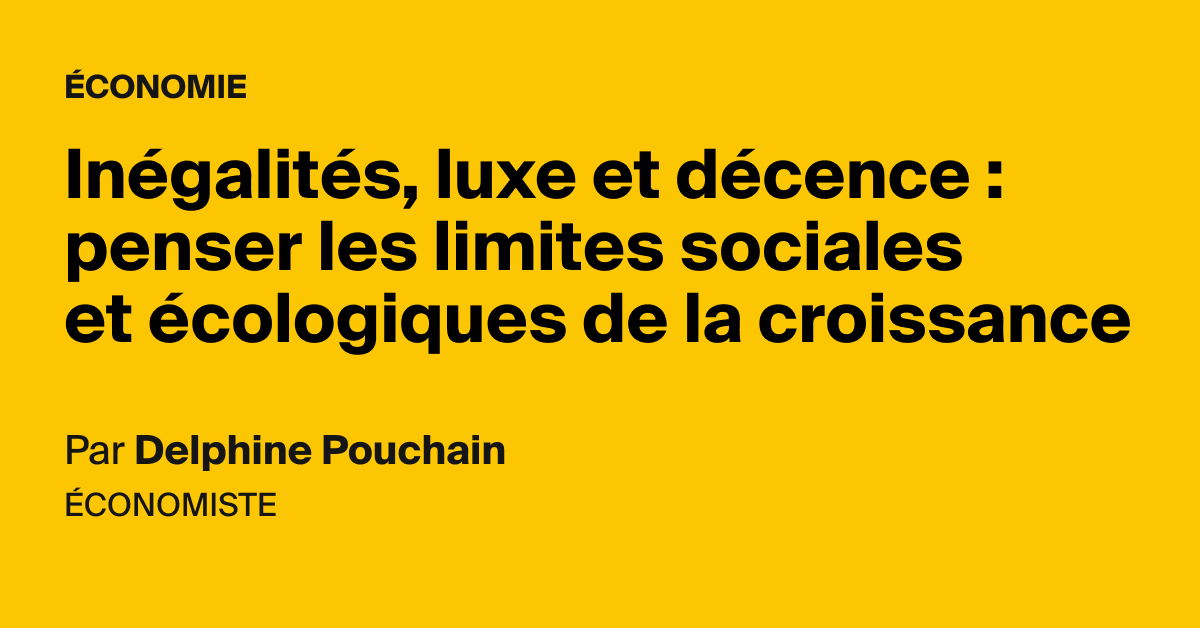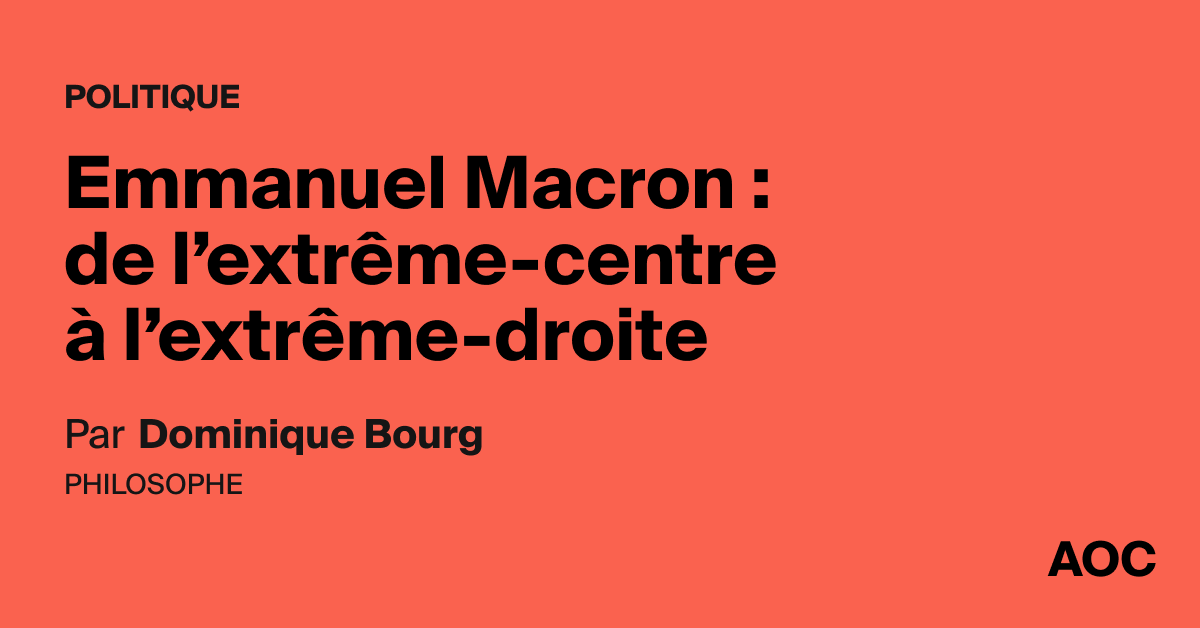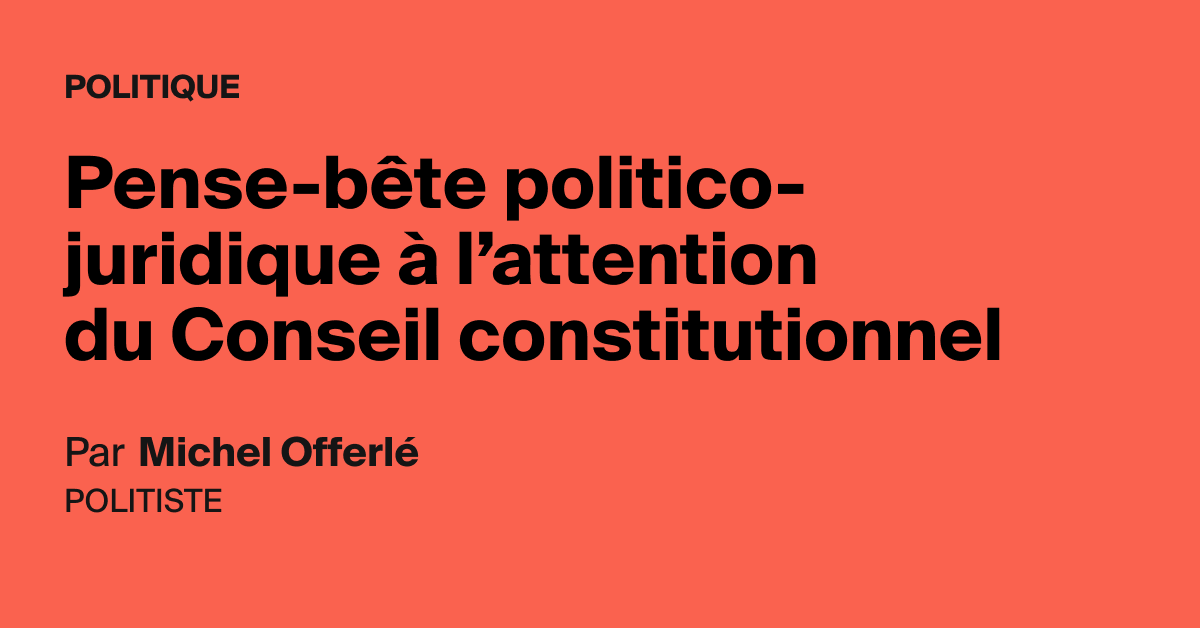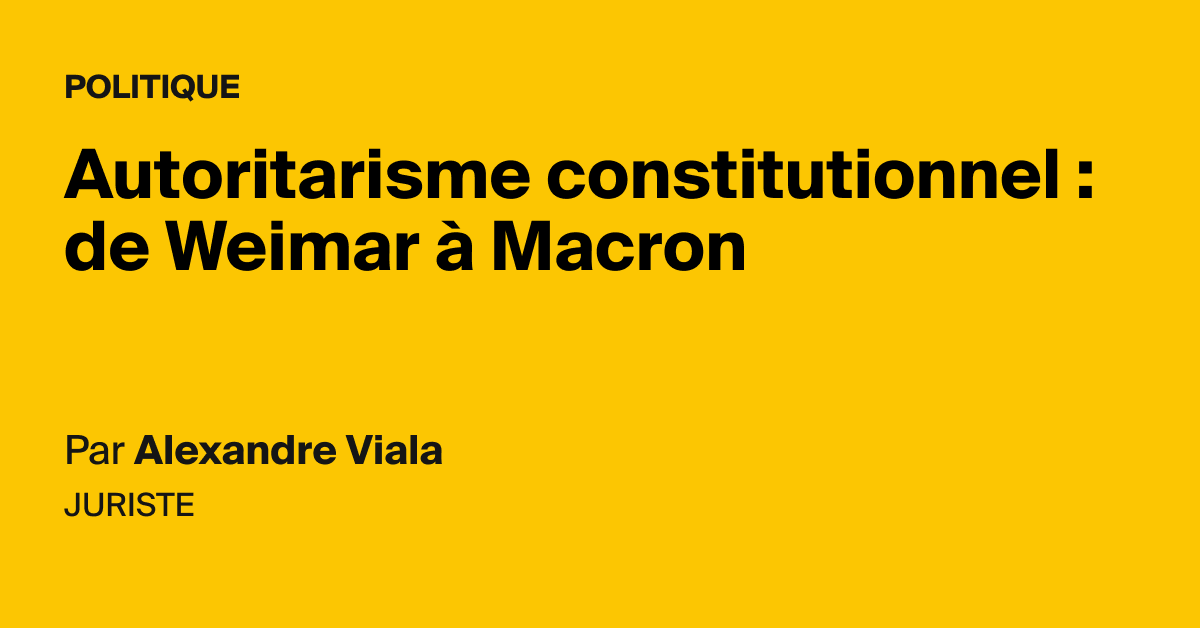Un article issu de la revue en ligne AOC – Analyse opinion critique.
Par Roger-François Gauthier, docteur en sciences de l’éducation, professeur associé à l’université Paris-Decartes.
Alors que le président Emmanuel Macron ne cesse d’appeler à « réarmer » l’école, ce slogan apparaît comme la poursuite de l’armement d’une certaine conception de l’école, pour effacer l’idéal d’une école commune et pour en faire un jeu aberrant de recherche de compétition et de « résultats ». Séparatiste et désespérante, une telle école est condamnée à devenir de plus en plus inégalitaire et à assigner les élèves perdants à des savoirs minimums.
« Réarmement » prescrit tous azimuts, école comprise, avec des adjectifs (comme « civique ») et des décisions du style « je ne veux voir qu’une oreille ! » à la clé… L’opinion, d’abord perplexe, se montre passive en se disant peut-être que, face au désarroi de la jeunesse et aux vices auxquels la conduirait l’oisiveté (le président de la République a explicitement esquissé la citation du proverbe !), toutes les activités annoncées au titre du réarmement joueraient le rôle qu’on attribue parfois aux clubs sportifs : « ça va au moins les occuper ! ». Et les éloigner du chemin du vice. Et de l’envie de manifester, puisque le même personnage a démontré qu’à l’origine de la mobilisation de bien des jeunes faisant suite à la mort de Nahel, il y avait leur désœuvrement consécutif à la désorganisation de la fin de l’année scolaire occasionnée par la réforme de son ancien ministre Blanquer (il serait alors le coupable ?) sur le baccalauréat ! Et non pas leur émotion, bien sûr, comme des naïfs ont pu le penser.
Prenons donc le mot à la lettre : il s’agirait non pas d’armer, mais de « réarmer ». C’est ce « ré » qui nous interroge. C’est-à-dire qu’on viserait l’atteinte d’un certain état d’« armement » qui aurait été celui de quelque passé. Alors que l’école contemporaine ne donnerait à voir que pacifisme béat et laisser-aller de permissionnaires en goguette ? Étrange : nous avons plutôt l’impression du contraire ! Et c’est ce que nous allons démontrer.
La stratégie, compétence fondamentale exigée des familles par l’école française dans la compétition sociale
C’est étonnant en effet, car en écrivant cela, on ne peut s’empêcher de songer à une réalité triviale : plutôt que de passivité béate, la réalité de beaucoup d’enfants, dès le collège, est celle d’un stress permanent face à la multiplication de « contrôles » dont le statut et les modalités sont loin de leur être clairs, trop souvent la morsure du jugement par l’échec, prélude au décrochage, l’obsession des préoccupations d’orientation, l’angoisse autour de Parcoursup, le développement dans beaucoup de milieux de véritables stratégies familiales visant à être dans « la » bonne classe « du » bon établissement, avec « les » bonnes options et spécialités, afin d’être admis dans « la » bonne filière d’enseignement supérieur, c’est-à-dire souvent dans une classe préparatoire permettant à la fois de garder le plus de choix possible et d’être « distingué » par ce qui est, en France, contrairement à ce qu’on lit souvent, bien plus efficace qu’un diplôme : une inscription sur sélection.
Cette réalité institutionnalisée de la compétition crée pour toutes les familles qui parviennent à s’y repérer une obligation de mettre en œuvre une véritable stratégie. Ne sommes-nous pas déjà là, et violemment, plongés dans une guerre ? Et ne s’agit-il pas alors, pour chacun, de s’« armer », sans même que l’État ait à s’en soucier, pour se tirer au mieux de ce parcours du combattant qu’est devenue en France la scolarité pour toutes les familles, vaincues ou victorieuses du grand combat.
Il convient toutefois de rappeler à ce stade que la situation est très différente dans d’autres pays, selon diverses modalités que la comparaison attentive à l’expérience scolaire réelle des élèves fait apparaître : si en certaines contrées, notamment celles marquées par la philosophie de Confucius, et quel que soit leur régime politique, la compétition est forcenée, à grand coup de cours du soir, il est d’autres cas, en Europe (faut-il citer l’Écosse ? l’Italie ? Des pays scandinaves selon les périodes ?) où la préoccupation de voir tous les enfants heureux pendant la scolarité et surtout quitter l’école avec un certain type de culture est bien plus présente et active que la compétition. Dans ces pays, c’est le monde social qui s’en charge, certes, mais avec une participation moindre du monde scolaire. Et cette configuration moins guerrière apparait dès les textes qui organisent l’éducation.
En un temps pas si lointain l’École fut une utopie
La France n’est toutefois pas une exception car un peu de recul historique nous montre qu’il s’agit, avec la compétition scolaire, d’une pandémie politique et sociale. Sans doute plus grave que son équivalent biologique car les États, loin de lutter contre elle, font tout pour la favoriser. La quasi-totalité des pays sont passés depuis une génération de l’optimisme confiant de l’après-guerre, dont par exemple la fondation de l’UNESCO est un témoignage fort, à une conception martiale et guerrière de l’éducation.
En effet, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand le concept d’État-providence avait le vent pour lui, quand les humains parlaient de Paix et de Droits de l’homme, malgré l’imminence de la tension entre les deux blocs de la « guerre froide », l’UNESCO parvenait à proclamer dans le préambule de son Acte constitutif que « les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. ». Établir une paix durable après les deux conflits mondiaux semblait imposer qu’elle s’établisse sur le fondement d’une solidarité construite au sein des systèmes et des politiques d’éducation.
Cet accord au moins consensuel entre les principaux pays de l’époque sur ce qui apparaissait comme une utopie à portée de main s’accompagnait d’un autre consensus diffus sur l’importance de l’éducation pour le développement, sur le bienfait que serait pour les populations la diffusion des lumières de la science, ou sur l’urgence, dans les décennies qui suivirent, du développement de systèmes d’éducation « pour tous » dans les pays qui accédèrent aux indépendances.
En France comme en d’autres pays qui étaient déjà dotés de systèmes d’éducation relativement puissants, ce même mouvement prit à la même époque la forme du développement de la « démocratisation » scolaire. En France fut instauré en 1975 un enseignement de type secondaire inférieur, baptisé collège, généralisé et commun à tous les élèves, visant l’accès de tous à autre chose qu’aux seules compétences basiques de l’enseignement primaire.
On ne voit pas toujours que dans l’histoire des systèmes d’éducation, il s’est agi à cette époque et pour la première fois de poser cette question de l’accès de tous les humains à ce que peuvent représenter les savoirs de l’enseignement dit « secondaire », c’est-à-dire des savoirs n’apparaissant pas comme immédiatement nécessaires pour la vie quotidienne. L’ambition était culturelle : c’est à ce genre de déraison que se risquaient les humains de l’après-guerre, pensant que cette espèce pouvait et devait s’aventurer au-delà de ce que d’autres appelleront plus tard des « fondamentaux ».
Puis l’état de guerre fut proclamé, de tous contre tous
Tout bascula dans la décennie 80 du siècle dernier : on se souvient que, selon des initiatives occidentales, l’idéologie néo-libérale, avec comme hérauts des personnages comme Margaret Thatcher et Ronald Reagan, proposa que l’éducation devienne une occasion de profit, l’État s’en désengageant peu à peu. Cela fut tout sauf anecdotique puisque, peu à peu, malgré la grande diversité des systèmes et des cultures éducatives des pays, on vit partout des intérêts privés investir dans l’éducation, en même temps que des familles adhéraient à la recherche pour leurs enfants d’une école distincte de l’école commune, leur donnant toutes leurs « chances » au sein d’un jeu total de compétition.
On ne perçoit pas toujours assez à la fois la raideur du virage ni la vitesse de son expansion. En quelques décennies, dans la quasi-totalité des pays, et quel que soit le régime politique, les gens ont pris l’habitude de considérer l’éducation comme un bien privé, à la définir en référence à la liberté individuelle, comme un « bien » à acquérir par des moyens privés, et dont les bienfaits ne sont pas à attendre à une échelle collective.
On vit les systèmes du monde entier dès lors se fracturer. Et on vit en effet la « compétition » se développer comme jamais entre les élèves, mais aussi ce qui était nouveau en certains pays, entre les établissements, mais aussi entre les sous-systèmes (entre privé et public, mais à l’intérieur de la sphère privée, entre plusieurs allégeances confessionnelles, pédagogiques, ou commerciales) et les systèmes nationaux eux-mêmes, comme cela apparut dans les classements internationaux réalisés notamment par l’OCDE sous le nom de PISA.
Alors, oui, si on y songe, c’est sans doute à cette guerre de compétition généralisée que pensent les dirigeants français, car, à tous niveaux, elle les arrange : au niveau national, en montrant qu’on fixe un cap, classique, à une nation, comme lorsqu’après la défaite de 1870 des éducateurs français allèrent voir ce qu’il y avait de mieux dans les écoles allemandes ; au niveau inter-système, en continuant à montrer, sans en analyser le pourquoi, que les établissements privés ont souvent de meilleurs « résultats » (du moins les établissements les plus élitistes) ; au niveau inter-établissements, en ce que cela soulignera des différences sur lesquelles on a peu de capacité d’agir et renforcera les ghettos ; enfin, entre les classes dans une même école et entre élèves, plus que jamais, qu’on continuera à accabler sous les constats menaçants selon lesquels « s’ils avaient plus travaillé… ».
L’escompte attendu par le pouvoir court-termiste
Si on se demande pourquoi les dirigeants actuels, après d’autres et comme d’autres ailleurs, ont décidé de retenir cette approche de l’école, on pourrait avancer les arguments suivants, qui sans doute se cumulent.
En premier lieu, il s’agit d’une simplification du paysage mental des populations, qui consiste à leur inculquer l’idée qu’il n’existe pas d’autre logique possible, nulle part, que celle de la soi-disant loi du capitalisme, faite de concurrence, de liberté de choix et de satisfaction des désirs par la consommation. Il s’agit bien sûr de satisfaire les dominants en renforçant le sentiment que l’inégalité des écoles et des gens est une fatalité : les vaincus sont dans leur tort, étant donné que le seul principe proclamé est celui de l’égalité des chances et qu’il correspondrait à la réalité.
Dans cette logique, il s’agit de ramener les questions d’éducation à une question de résultats à atteindre par les élèves et les systèmes, mais en faisant totalement l’impasse sur la question des finalités à poursuivre. L’éducation n’est pas appelée à « se penser », à faire l’objet de décisions politiques, il ne s’agit que de questions managériales, du ministère à la salle de classe.
Ensuite, par un recours aux vocabulaires à la fois guerrier et de restauration d’un ordre mythique, il s’agit de répondre à un besoin de sécurité proclamé de citoyens et citoyennes inquiets face aux menaces diverses qui pèsent sur le « monde commun ».
Enfin, il s’agit de poursuivre à l’échelle nationale le programme mondial, depuis Thatcher et Reagan, selon lequel l’argent privé doit s’investir et fructifier dans le champ de l’éducation, principe économique et politique particulièrement actif et productif à l’heure des technologies numériques.
Le désarmement programmé du « commun »
Malgré le caractère martial des annonces, rien ne se passera d’autre que le renforcement du système actuel, rendu plus efficace et assuré dans ses constantes nuisibles. En revanche, un résultat important en termes idéologiques est attendu, à savoir effacer pour longtemps tout ce qui pourrait tracer le chemin d’une éducation commune, qui privilégierait deux choses. D’une part, la maîtrise par tous les élèves d’une culture commune servant de répertoire commun de références à la collectivité nationale. En cela le projet d’école « réarmée » selon l’actuel gouvernement est une école séparatiste.
D’autre part, la constitution d’une école qui ferait ce qu’elle dit, à savoir mettre les élèves dans l’enfance sur un pied d’épanouissement comparable, permettant à tous d’envisager la poursuite de la vie et des études de leur choix. En cela le projet d’école « réarmée » selon l’actuel gouvernement est une école désespérante.
« Culture commune », « collège unique », « socle de culture », « démocratisation de l’école », « école inclusive », ce sont tous ces termes et références qui devront être abandonnés. En cela, le « réarmement » annoncé n’apportera rien, sauf le « désarmement » de tout ce qui a trait à l’école commune. Tout un rêve international et séculaire, proclamé par les Nations unies à hauteur d’humanité, se trouve ainsi interrompu et révolu.
Ne nous cachons pas que l’heure est grave : le pouvoir politique dispose en effet pour arriver à ses fins d’atouts incontestables, comme le recours à deux imaginaires inscrits depuis longtemps dans les esprits. L’imaginaire du « résultat » plaide en faveur de tout ce qui peut permettre d’améliorer des « résultats » ou d’en cultiver la religion, comme le management ou encore les neurosciences qui voient dans la recherche de « l’efficacité » la fin des fins, ce qui permet d’éviter de poser la question des finalités communes. Des « moyens » justifiés par aucune « fin » ! Et l’imaginaire de la « méritocratie » et la croyance dans la valeur des jugements portés par l’école (les notes, les examens, les décisions d’orientation) ainsi qu’à la valeur par essence des savoirs qu’elle enseigne, constituent un univers mental qui, à gauche comme à droite, empêche depuis longtemps de penser l’éducation.
Le travail de dénonciation ne suffira pas : il faut en effet réarmer l’idée de commun et ne pas craindre de proclamer que c’est elle que nous opposons à l’idée de l’école séparatiste et désespérante présentée par le trio gouvernemental. Macron a d’ailleurs fait de l’école son « domaine réservé », sans respect de la Constitution, montrant par là quelque acharnement, qui doit nous inquiéter tous, à réaliser son programme.
Autre chose est pourtant urgent à faire ! Au nom de l’humain
Ainsi donc le slogan « réarmer » nous apparaît bien comme la poursuite de l’armement d’une certaine conception de l’école, conforme à celle de nombreux pays, qui sont même « en avance » sur la France, pour effacer l’idéal d’une école commune et pour en faire un jeu aberrant et méchant de recherche de compétition et de « résultats ».
L’école sera ce qu’elle devient partout, de plus en plus inégalitaire, et donc limitant et assignant les élèves perdants à des savoirs minimums. Ce qui, bien sûr, aura une signification en termes généraux, l’espèce entière pouvant, comme certains futurologues le laissent craindre, être de plus en plus fortement et irrémédiablement fracturée selon l’accès aux savoirs qui aura été organisé à cette fin.
C’est pour atteindre cet état qui ne gêne en rien les dirigeants qu’ils proposent de « réarmer » en reprenant les mauvaises recettes de ce qu’ils appellent le passé : on peut bien sûr citer les soi-disant fondamentaux renvoyant fallacieusement à l’école primaire de la Troisième République, la réinstauration de « groupes de niveaux », qui mettent à l’écart des élèves en les privant d’opportunités de découverte d’enseignements autres que ceux dans lesquels ils éprouvent des difficultés, le retour du redoublement qui a été jusqu’à récemment une tare du système français, l’invention d’un brevet comme examen d’entrée au lycée, qui n’est qu’une reprise de l’ancien examen d’entrée en sixième, sans même parler de la contre-référence historique à quelque uniforme.
On est ainsi certains que rien ne va changer, et que l’existant coupable va au contraire être renforcé, avec le discours ressassé sur l’égalité des chances, non seulement menteur, mais pervers en ce que l’école n’est pas une affaire de chance, mais vise le développement émancipateur de chacun.
Pourtant !
Que notre rejet du « réarmement » proposé par Macron et ses ministres ne laisse pas croire que nous pensons que s’en tenir à la situation actuelle de l’école en France ou à un de ses états antérieurs serait la solution ! Nous avons dit ailleurs[1] en quoi elle pèche par injustice et conservatisme, les deux se mêlant pour expliquer l’échec des « réformes » régulièrement envisagées, que le gouvernement soit à gauche ou à droite.
Mais puisqu’il nous est proposé d’« armer » les positions, allons-y en avançant deux idées.
Tout d’abord, l’école de France doit être libérée des ordres anciens auxquels, sans que les acteurs le sachent la plupart du temps, elle obéit, qu’il s’agisse de son élitisme littéraire hérité des collèges jésuites, avec toute une hiérarchisation indue des savoirs née dans ce contexte, qu’il s’agisse d’une tonalité scientiste héritée des Lumières, qu’il s’agisse surtout de ce qu’on a appelé son prométhéisme, à savoir son inscription dans une histoire construite autour des industries extractives, des nationalismes du XIXe siècle, des empires coloniaux et des situations post-coloniales sans définir d’autre rapport humain/nature que celui de l’exploitation sans limites.
Également, l’école de France doit renouer avec les débats et les grandes interrogations politiques sur son rôle, ses frontières, son lien avec les savoirs extérieurs à l’école et sur les finalités qu’elle retient collectivement.
À l’heure où le modèle ancien d’éducation assis sur ses certitudes abusives a échoué face aux crises contemporaines du savoir, l’école doit jouer le rôle exactement contraire de celui que propose le réarmement gouvernemental : un rôle délibérément utopique. C’est-à-dire faire et proposer aux gouvernements du monde que soit fait ce qui ne l’a jamais été : définir l’éducation à partir de ce qu’elle est pour tous les membres de l’espèce humaine, c’est-à-dire enseigner l’humain à l’humain, partout, en demandant toute son aide à l’anthropologie scientifique. Pour y gagner quoi ? D’approcher vraiment le commun, de pouvoir peut-être définir l’éducation comme « bien commun de l’humanité ».
Ce qui bien sûr pose au cœur de l’éducation tellement dévorée en l’état par la folie de la compétition la question du traitement du désir de puissance. Et ce ne sont certainement pas les systèmes scolaires qui prônent divers nationalismes et intégrismes, ou qui valorisent, dans l’esprit du deuxième amendement de la Constitution des États-Unis d’Amérique, la droit pour tous de porter des armes, qui sont d’une grande lumière sur la question.
Face au réarmement du jeu néo-libéral complexe face à l’école, proposons l’utopie, qui vise un peu plus haut que les pense-petits du redoublement et de l’uniforme ! Car il faut, et sans délais, se demander partout comment, face aux trois urgences de la vérité, du vivant, et de l’amour de l’autre, une vision large de l’éducation commune peut jouer son rôle dans la recherche de solutions sans trompe l’œil[2].
[1] Voir notamment Philippe Champy et Roger-François Gauthier, Contre l’école injuste, ESF, 2022, et « Quels savoirs pour une école juste ? », AOC, 27 septembre 2022.
[2] Des jalons forts existent, comme le rapport de l’UNESCO, Repenser nos futurs ensemble : un nouveau contrat social pour l’éducation, élaboré par la Commission internationale sur Les futurs de l’éducation.
#politique #société #éducation #enseignement #néolibéralisme #séparatisme #commun #Macronie #AOC